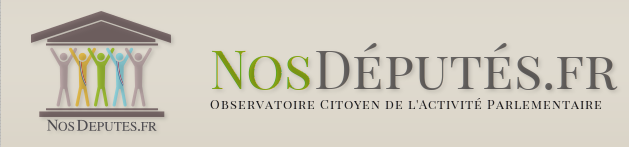Commission des affaires européennes
Réunion du mardi 7 mai 2024 à 13h30
La réunion
COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Mardi 7 mai 2024
Présidence de M. Pieyre-Alexandre Anglade, Président de la Commission,
La séance est ouverte à 13 heures 35.
I. Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture (n° 2436) : examen du rapport d'information portant observations (Mme Aurélie TROUVÉ, rapporteure d'information)

L'ordre du jour appelle l'examen du rapport portant observations sur le projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations présentées par notre collègue Aurélie Trouvé. Ce projet de loi sera présenté en séance à partir du 14 mai.

Je vous remercie de m'accueillir à nouveau dans votre commission pour débattre des questions agricoles et plus précisément de la politique agricole commune (PAC), sujet auquel j'ai consacré une grande partie de mes recherches en tant qu'enseignante chercheuse.
J'évoquerai les articles du projet de lois qui entrent le plus directement en résonance avec les politiques de l'Union européenne. Trois sujets ont retenu plus particulièrement mon attention : la souveraineté alimentaire, l'aide aux candidats à l'installation ainsi que la question des infrastructures agroécologiques, dont les haies.
En propos liminaires, je me dois de rappeler que le PJLOA a suscité beaucoup d'attentes et d'espoirs dans le monde agricole. À mon sens, le texte présenté reste très insuffisant pour répondre au défi de la souveraineté alimentaire et du renouvellement des générations en agriculture. Il ne permet pas non plus de répondre à la revendication principale des agriculteurs, exprimée lors de la mobilisation des dernières semaines : disposer d'un revenu digne.
Concernant la souveraineté alimentaire, la définition retenue par le texte reste malheureusement dans la même ligne que la conception et l'orientation des politiques européennes qui réaffirment l'importance du marché intérieur et des engagements internationaux. Cette conception se trouve être à l'opposé de la définition proposée, pour la première fois, en 1996, par le syndicat agricole, Via Campesina, dans le cadre du Sommet mondial de l'alimentation des Nations Unies. En effet, cette conception reconnaît un droit pour chaque pays à maintenir et développer sa propre capacité à produire son alimentation de base.
Or, les politiques européennes se trouvent en contradiction avec cette conception de la souveraineté alimentaire.
Il n'y a presque pas de moyens ciblés sur les secteurs les plus importateurs nets qu'ils soient français ou européens. En France, depuis 2013, pour ces secteurs, la balance commerciale s'effondre.
De manière plus générale, le nombre important d'accords de libre-échange mis en œuvre a eu de graves effets cumulés sur la souveraineté alimentaire. Le maintien de dérogations temporaires décidées dans le cadre de la crise ukrainienne, avec ouverture totale des frontières commerciales agricoles, fragilise certaines grandes productions européennes telles que les volailles et les céréales.
S'agissant plus précisément de la PAC et des dispositions du projet de loi qui la concernent, je tiens à rappeler le rôle absolument crucial de cette politique pour l'agriculture française. La PAC représente environ dix milliards d'euros d'aides par an soit vingt-cinq mille euros par bénéficiaire. Ce montant correspond parfois à la totalité du revenu agricole d'une exploitation. Sans la PAC, beaucoup d'agriculteurs ne survivraient pas.
Concernant l'installation des nouveaux agriculteurs, le dispositif mis en œuvre dans le cadre du plan stratégique national de la PAC est-il efficace ? Les aides à l'installation, qui relèvent du second pilier de la PAC, sont depuis le 1er janvier 2023, entièrement décentralisées, avec les régions comme autorité de gestion. Or, selon les acteurs, sur le terrain, de nombreuses inégalités existent entre régions car ces dernières sont autonomes pour compléter les conditions d'éligibilité ainsi que les montants versés. En conséquence, l'égalité d'accès aux aides entre agriculteurs est remise en cause. Il me paraît absolument essentiel de renforcer les aides à l'installation mais également de mettre en place, a minima, un système de péréquation pour rendre la distribution des aides sur le territoire égalitaire.
Concernant la question des infrastructures agroécologiques, je tiens à rappeler que la transition agroécologique pour une adaptation de nos systèmes agricoles aux dérèglements climatiques est incontournable. L'agriculture doit prendre sa part pour répondre aux crises liées au changement climatique, à la diminution de la biodiversité ainsi qu'à la pollution des milieux naturels. J'ajoute que les infrastructures agroécologiques jouent un rôle positif dans les systèmes de production tels que la protection du vent, le maintien de l'hygrométrie et des températures ainsi que la lutte biologique contre les nuisibles.
Depuis les années quatre-vingts, le volet environnemental de la PAC s'est beaucoup développé. Ce texte arrive à un moment de rupture puisqu'un certain nombre d'États membres, dont la France, ont été à l'initiative pour remettre en cause certaines avancées environnementales à l'échelle européenne. En effet, les bonnes conditions agroenvironnementales (BCAE), qui sont des conditions environnementales de base pour percevoir les aides du premier pilier, font l'objet d'un certain nombre de remises en cause inquiétantes. L'obligation d'avoir au moins 4 % de la surface agricole utilisée (SAU) avec des éléments d'infrastructures agroécologiques tels que les haies, les bosquets ou les jachères, par exemple, a été à nouveau interrogée.
En conséquence, une minorité d'agriculteurs ne respectant pas ces règles, tels les grands céréaliers du plateau de la Beauce, sont favorisés par rapport aux agriculteurs qui les respectent et qui devront continuer à maintenir les infrastructures agroécologiques existantes dont les haies. Ce phénomène est particulièrement grave lorsque l'on sait que vingt-cinq mille kilomètres de haies disparaissent chaque année et que soixante-dix pour cent ont déjà disparu.
Enfin, le projet de loi présente sous la forme d'une simplification administrative ce qui relève en réalité d'un torpillage du droit de l'environnement. L'évolution de l'échelle des peines à l'article 13 s'apparente davantage à de la dépénalisation et de la déjudiciarisation d'une partie des délits alors même que la magistrature s'inquiète d'une insuffisance présence du droit pénal dans le domaine de l'environnement.
De même, le principe de compensation posé à l'article 14, qui facilite la destruction des haies, n'apporte pas de garanties suffisantes. En effet, en déplaçant une haie ancienne, de cinquante ans d'existence, cent mètres plus loin, on porte préjudice aux écosystèmes.
Ainsi, ce texte comporte trop de lacunes pour pouvoir répondre aux défis contemporains que sont la rémunération des agriculteurs, l'aide à l'installation pour faciliter le renouvellement des générations et la transition agroécologique.

J'ai lu votre rapport avec attention. Il soulève des questions essentielles dans le contexte de crise agricole que nous vivons en France et en Europe. Le chef de l'État et le chef de Gouvernement ont agi de concert pour porter une action tant au niveau national qu'au niveau européen. Le président de la République a ainsi, lors du dernier Conseil européen, incité la Commission à adopter une réforme ciblée et urgente de la PAC, à travers un effort de simplification des bonnes conditions agroécologiques et environnementales (BCAE), dont la BCAE 9. Cette simplification a été votée par le Parlement européen au mois d'avril. Au niveau national, c'est le projet de loi d'orientation agricole qui nous occupe et qui a été présenté par le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire autour d'un objectif principal : préserver notre souveraineté agricole et alimentaire et relever le défi du renouvellement des générations et des transitions climatiques. Votre rapport se concentre sur l'avenir de l'agriculture européenne et de la PAC. Je me réjouis de la mise en avant par une députée du groupe de la France Insoumise de la dimension européenne de notre agriculture. Vous identifiez trois sujets de préoccupation dans votre rapport. Permettez-moi de vous rassurer.
Vous déplorez en premier lieu l'absence d'une définition du concept de souveraineté alimentaire. La France est aujourd'hui la sixième puissance exportatrice de produits agricoles et de produits agro-alimentaires au monde. Cela permet à notre pays mais aussi à l'Union européenne d'être souverains sur le plan agricole. Nous devons bien sûr le rester. Notre agriculture est un élément essentiel de notre puissance économique, de notre rayonnement international ainsi que de notre identité. Cela explique pourquoi nous faisons de notre souveraineté alimentaire un élément structurant de nos politiques publiques. Parmi vos recommandations, celle relative à l'institution d'indicateurs de suivi pour mesurer notre souveraineté alimentaire va être comblée par l'article 1er du projet de loi.
Vous croyez ensuite percevoir un manque d'ambition concernant le renouvellement des générations : je ne peux pas être en accord avec vous. Ce projet de loi pose les bases d'un renouvellement générationnel, au sein d'une profession affectée par une crise démographique sans précédent, avec un certain nombre de mesures visant à renforcer l'attractivité du secteur et l'accompagnement.
Enfin, vous soulevez une ambiguïté concernant le processus de simplification. Pour moi, aucune ambiguïté subsiste dans ce projet de loi qui vise à sécuriser, simplifier et libérer l'exercice de l'activité agricole. Il s'agit d'une demande fondamentale de nos agriculteurs auquel ce projet de loi répond.

Je tiens, au nom de mon groupe, à exprimer notre plus vive préoccupation concernant le projet de loi d'orientation agricole sur la souveraineté agricole et sur le renouvellement des générations en agriculture. De la même manière, les conclusions du rapport sur lequel nous nous sommes fondés pour intervenir aujourd'hui n'ouvrent pas, ou si peu, de perspectives pour nos paysans et l'avenir de l'agriculture française.
Tout d'abord, nous partageons avec vous cette nécessité de bien définir le concept de souveraineté alimentaire. Sous l'impulsion confuse du « macronisme » qui, depuis sept ans, cherche toujours à trouver une boussole, nous nous voyons proposer une définition opposée à notre objectif qui est de tendre vers une souveraineté alimentaire incluant les produits transformés, la plus locale possible tout en garantissant un revenu correct à nos agriculteurs. Parfois même, cette définition de la souveraineté alimentaire est contradictoire lorsqu'elle se confond avec les accords de libre-échange et les lois du marché. Il est clair que pour ce rapport la souveraineté ne peut être qu'européenne, alors que pour nous, elle ne peut être que nationale, définie au niveau de chaque État membre.
Cette ambiguïté rend difficile l'élaboration de politiques concrètes et mesurables. Comment, en effet, garantir une souveraineté alimentaire durable si le concept n'est pas clairement défini ? Nous avons besoin d'indicateurs solides pour mesurer efficacement notre indépendance agricole et adopter des politiques qui renforcent réellement notre autonomie.
Concernant le soutien aux agriculteurs, je dois souligner la timidité du rapport qui n'interroge même pas la question de la répartition plus juste des aides de la PAC.
Pour beaucoup, le projet de loi ne répond pas aux préoccupations réelles des agriculteurs. La question du renouvellement des générations, essentielle, est posée avec le départ de nombreux exploitants à la retraite sans assurance que leur exploitation ne soit reprise. Pour soutenir les jeunes agriculteurs, notre mouvement, le Rassemblement national, propose notamment l'abrogation des lois de succession pour un agriculteur qui reprend une exploitation pour une durée minimale de dix ans. Sur la simplification des règles environnementales, j'aurais envie de vous dire qu'il aurait suffi de ne pas les complexifier pour n'avoir pas aujourd'hui à les simplifier. Pour autant, je crains que les mesures proposées ne soient pas suffisamment ambitieuses pour soulager les agriculteurs des lourdeurs bureaucratiques tout en garantissant la protection des haies et de la biodiversité. La simplification doit demeurer une priorité sans compromettre nos engagements environnementaux.
Tant le Gouvernement que l'Union européenne doivent renouer avec des aides incitatives et rémunératrices au lieu de matraquer et sanctionner nos agriculteurs. Les agricultures nationales ont un rôle majeur à jouer sans nier que la PAC est essentielle. La France doit prendre ses propres mesures et défendre ses intérêts. Nous devons donc être proactifs et proposer un projet de loi bien plus ambitieux.

Au moins cette réunion de commission aura eu le mérite de montrer à notre collègue Constance Le Grip, je dis cela en toute amitié, que la France insoumise n'est pas opposée à l'Europe, bien au contraire, mais pour une Europe qui protège ceux qui y habitent et non pas ceux qui spéculent.
La situation d'urgence dans laquelle se trouve aujourd'hui le monde agricole est une évidence sur laquelle nous nous accordons tous. Concurrence des produits ukrainiens, fiscalité du gazole non routier, renchérissement des intrants : les origines de la colère paysanne sont nombreuses, celles de nos concitoyens également. L'exigence est partout la même : nos agriculteurs veulent vivre dignement de leur activité. Malheureusement une majorité écrasante d'entre eux ne le peut pas. Les économies permanentes accentuent la profonde crise sociale qui touche le monde rural. Le manque de renouvellement des générations se nourrit d'un double mouvement : d'une part, des spéculations foncières artificialisant les sols à coups de projets immobiliers ; d'autre part, une concentration accrue des terres dans les mains toujours moins nombreuses de grands groupes industriels aux pratiques agro-intensives dangereuses tant pour les hommes que pour la terre.
Troisième aspect de la véritable menace qui pèse sur le monde agricole : au dérèglement climatique qui menace la viabilité des agricultures, l'industrialisation de notre agriculture productiviste est venue ajouter l'épuisement des sols et la destruction de la nature. Or, sans nature, pas d'agriculture. Le rapport de notre collègue Aurélie Trouvé permet de souligner les failles du projet de loi d'orientation agricole examiné ces jours-ci par la représentation nationale. Plutôt que d'assainir les fondements économiques, sociaux et agronomiques de nos modèles agricoles, ce texte ira au mieux rejoindre le cimetière des actes manqués. Car sans le dire explicitement, le texte continue de nourrir l'opposition entre agriculture et environnement. Ce gouvernement a toujours préféré ménager les intérêts établis pour leur sacrifier l'intérêt général, en l'occurrence la santé de nos sols et de nos agriculteurs et à terme la souveraineté alimentaire de notre pays. Les faux-semblants du « en même temps » ne sont qu'un renoncement illustré par les paradoxes du plan Ecophyto. L'abrogation du plan de réduction de l'utilisation des pesticides est un scandale économique, écologique et sanitaire. Comme le fait remarquer le professeur Marc-André Selosse du Muséum d'Histoire naturelle, le changement d'indicateurs de notre consommation de produits phytosanitaires qui abandonne l'indice français – plus exigeant – pour un indice européen dont les scientifiques dénoncent l'inadéquation équivaut à une simple réduction des contraintes conforme à certaines attentes syndicales. Pourtant, le ministre déclare ouvrir en même temps la possibilité de mettre en œuvre et de financer un mécanisme d'indemnisation des riverains ayant contracté une maladie en lien avec l'exposition prolongée et répétée à des produits phytopharmaceutiques. Une façon discrète, convenons-en, et implicite, de reconnaître qu'un danger existe tant pour les riverains que pour les agriculteurs qui manipulent ces substances en masse. Ce n'est qu'un exemple mais il illustre comment ce projet de loi continue à creuser le même sillon, celui d'un modèle condamné par ses propres excès ainsi que par le déni permanent de la science écologique. Ce modèle oublie que la base de l'agriculture ; c'est la science et les hommes. C'est là que réside la véritable menace sur notre souveraineté alimentaire nationale et européenne.

La rapporteure et moi-même avons une conception de l'agriculture éminemment différente. Toutefois, je pourrais tout à fait me retrouver dans le début du propos de notre collègue Rodrigo Arenas tant sur le constat qu'il dresse que sur les causes de la crise agricole majeure que nous traversons. Pour le reste, je pense que nos agriculteurs sont avant tout des chefs d'entreprise avec des contraintes qui s'exercent sur eux et qu'il faut considérer comme telles.
Je fais également le constat que ce projet de loi ne permet pas d'aborder les principaux sujets que sont les charges et les questions fiscales. Il manque tout un volet financier à propos duquel nous aurions aussi une approche très différente. Je ne vois pas demain nos agriculteurs vivre décemment, être compétitifs, développer leur entreprise, tout en recréant des kolkhozes, en les fonctionnarisant, ou en les enfermant dans de trop petites fermes. Je vous prie de ne pas prendre mal cette caricature. Mon propos consiste seulement à rappeler que faire de la politique, c'est opérer des choix. Ces derniers temps, des efforts ont été faits chiffrés à quelques centaines de millions d'euros par le Gouvernement. Toutefois, lorsque le RSA est revalorisé de 4,6 %, au 1er avril, cela représente 700 millions d'euros, soit le double de l'effort financier en faveur des agriculteurs en réponse à la crise du début de l'année.
Beaucoup d'aspects du projet de loi vont permettre de traiter les questions de manière trop superficielle, notamment concernant le renouvellement des générations. La question de l'accès à la terre, la taille des fermes, et la manière dont il est possible d'accompagner les nouveaux agriculteurs qui n'ont pas de racines agricoles est tout aussi fondamentale.
Enfin, la notion de souveraineté alimentaire est essentielle. Je rejoins les propos de mes collègues estimant que le concept de souveraineté alimentaire est mal défini dans le PJLOA. Cependant, aujourd'hui, dès que des contraintes sont ajoutées ou que le niveau de production recule en France, les produits sont remplacés par des importations dont nous ne maîtrisons pas le processus de production, ce qui s'avère très inquiétant pour la santé de la population. Vous avez évoqué les produits étrangers, les accords de libre-échange ainsi que les produits ukrainiens arrivés en masse depuis deux ans sur notre sol, questions qui se traitent au niveau européen, et ont un impact majeur sur la compétitivité de l'agriculture française. Il faut le garder en mémoire sans pour autant l'aborder ainsi.

L'agriculture française doit être définie dans un cadre européen. Elle est au fondement de la construction européenne puisque la PAC était prévue dès le traité de Rome. La PAC a atteint son objectif de produire suffisamment pour nourrir les Européens, alors que le continent connaissait encore des crises alimentaires et des famines dans les années 1950. Nous devions alors importer de nombreuses productions du sud de la Méditerranée ou d'autres continents. L'Europe a maintenant atteint un niveau d'autosuffisance et la souveraineté sur les principales productions alimentaires.
Il est nécessaire de répondre aux craintes des agriculteurs français, tout en gardant en mémoire que la PAC a permis à l'agriculture française d'acquérir les capacités d'exportations qui sont les siennes.

Mme Constance Le Grip, vous indiquez que la France est la sixième puissance exportatrice agricole du monde. Certes, mais elle a jadis occupé la deuxième place du classement. Je ne crois pas que l'on puisse se féliciter de cette baisse. La balance agricole française est en diminution constante depuis 2013. Sans le vin, la France est importatrice nette. Elle est par ailleurs devenue importatrice nette, vin inclus, vis-à-vis des autres pays de l'Union européenne et de l'Europe depuis plusieurs années, alors même qu'elle était présentée comme le grenier de l'Europe.
M. Charles Sitzenstuhl, vous soulignez les succès de l'Europe en matière d'autosuffisance. Cependant, la France l'est de moins en moins concernant les secteurs en situation d'importation nette. La situation semble évoluer dans le même sens dans l'Union européenne, comme le montre l'exemple des protéines végétales.
La PAC a connu un succès considérable jusqu'en 1992. Je m'appuie sur les travaux d'Edgar Pisani, qui a travaillé en France à la mise en place de cette politique et qui indique que nous devrions faire évoluer la PAC pour affronter les nouveaux enjeux.
Le groupe parlementaire de la France insoumise fait partie d'un groupe parlementaire qui a voté contre la réforme de la PAC car son budget est en constante baisse. La politique agricole est de plus en plus « à la carte » et concurrentielle et il existe de moins en moins d'outils communs à l'échelle européenne. Nous souhaitons une politique agricole réellement commune grâce à laquelle la France et les États membres pourraient retrouver une forme de souveraineté alimentaire nationale, ce qui était l'un des objectifs originels de la PAC.
Mme Joëlle Mélin, il existe effectivement un problème du point de vue des logiques de distribution des aides directes de la PAC aux agriculteurs, qui se font par hectare. Il s'agit de subventions indirectes au capital foncier, là où l'emploi agricole pourrait être favorisé si le versement des aides directes était assis sur les actifs et non sur les surfaces agricoles. Au niveau national, les PSN peuvent prévoir un plafonnement par actifs agricoles. Il ne s'agit pas uniquement de la responsabilité de l'Europe.
Les aides européennes perdent de plus en plus leur légitimité car elles ne sont plus des aides aux revenus, des aides selon l'état des prix agricoles, des aides à l'actif et à l'emploi, des aides en fonction des services environnementaux, ou des aides qui ciblent des productions en danger, mais des aides au capital foncier.
M. Fabien Di Filippo, je considère également les agriculteurs comme des chefs d'entreprise. Nous ne sommes ni pour fonctionnariser ni pour instaurer des kolkhozes. Pour rappel, ce qui s'apparente le plus, par leurs tailles, à des kolkhozes, ce sont les agrifirmes. Nous souhaitons une agriculture familiale dont les facteurs de production seraient la propriété des agriculteurs et des personnes travaillant sur les exploitations agricoles. Ce projet de loi d'orientation agricole fragilisera cette agriculture. Nous avons voté ensemble pour rejeter l'article 12 qui ouvre à la finance l'accaparement du foncier agricole.
Enfin, la question des importations a également une portée nationale puisqu'un État membre peut demander d'activer la clause de sauvegarde pour des raisons sanitaires, ce que la France a demandé à propos du diméthoate, un pesticide avec lequel étaient traitées des cerises importées. Je considère que nous n'activons pas suffisamment cette clause de sauvegarde tant à l'échelle nationale qu'européenne. C'était l'objet d'une proposition de résolution européenne que j'ai présenté devant votre commission.
La commission a ensuite autorisé le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.
II. Nomination d'un rapporteur
La Commission a nommé sur proposition de M. le Président Pieyre-Alexandre Anglade, M. Nicolas Sansu, rapporteur sur la résolution européenne exceptionnelle sur le patrimoine des contribuables les plus riches afin de financer la transition écologique (n°°2516).
La séance est levée à 14 heures 15.
Membres présents ou excusés
Présents. – M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Rodrigo Arenas, M. Fabien Di Filippo, Mme Marietta Karamanli, Mme Constance Le Grip, Mme Joëlle Mélin, M. Nicolas Sansu, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Aurélie Trouvé
Excusés. – M. Frédéric Petit, Mme Michèle Tabarot, Mme Liliana Tanguy, Mme Estelle Youssouffa
Assistaient également à la réunion. – M. Jean-Luc Warsmann et M. Thierry Mariani (député européen).